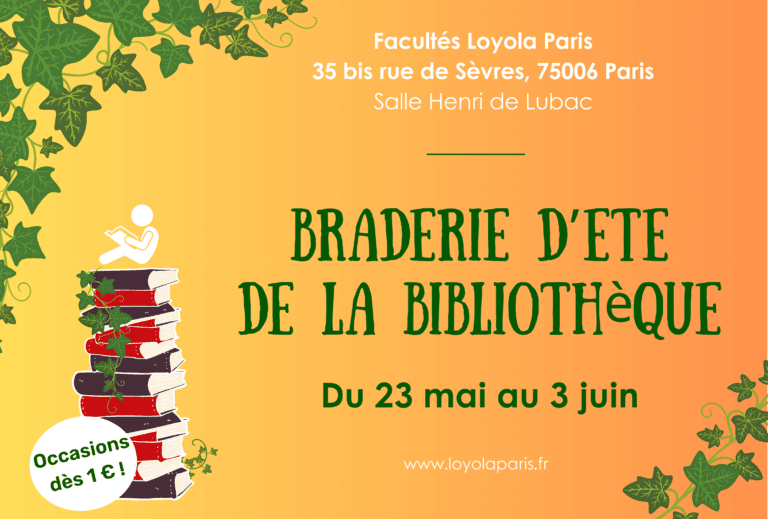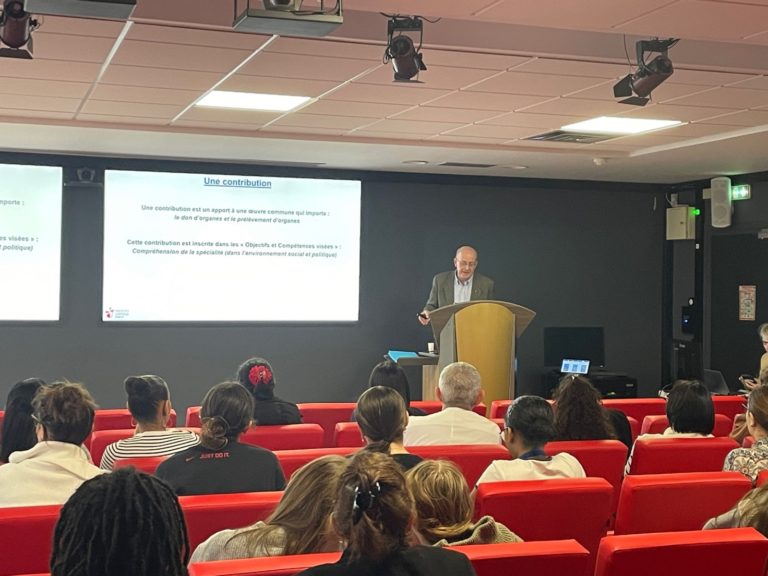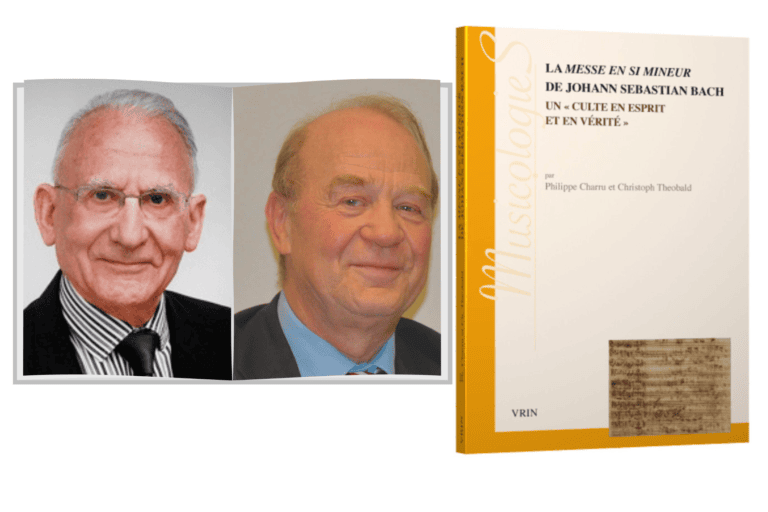Thèse : « Trinité et divinisation chez Grégoire de Nazianze – Un modèle d’inculturation de la tradition biblique »
De Yao Abel-Elisé ALLOKO

Yao Abel-Elisé ALLOKO a soutenu le 15 décembre 2023 aux Facultés Loyola Paris sa thèse en théologie patristique, sous la direction de Michel FÉDOU.
Composition du jury : Mme Catherine BROC-SCHMEZER, professeur à l’Université Jean Moulin de Lyon 3 ; Pierre MOLINIÉ, président du jury et maître de conférences aux Facultés Loyola Paris ; Michel FÉDOU, directeur de la thèse et Charbel MAALOUF, maître de conférences à l’ICP.
Titre de la thèse : « Trinité et divinisation chez Grégoire de Nazianze – Un modèle d’inculturation de la tradition biblique »
Résumé de la thèse :
« Le présent travail se propose de mener une recherche sur le phénomène de l’inculturation chez Grégoire de Nazianze à travers l’étude des deux pôles qui structurent et unifient sa pensée, à savoir la Trinité et la divinisation. Ce choix a été motivé par certaines raisons spécifiques. Notons en premier lieu notre découverte du caractère incontournable de la culture dans la doctrine de Grégoire et dans ses réflexions exégétiques. Dans un deuxième temps, l’invitation du Magistère à explorer le dialogue entre Bible et culture dans l’Antiquité. En troisième lieu, nous avons constaté que, même si certaines études sur le Nazianzène se sont intéressées aux pôles nommés, aucune d’elles ne traite de manière conjointe la question de la Trinité et de la divinisation en interrogeant systématiquement, sous les dimensions doctrinale et culturelle, chacun des points fondamentaux qui les constituent. En outre, certains points qui composent ces deux pôles n’ont fait l’objet d’aucune étude. Enfin, soulignons qu’en tant qu’africain soucieux de contribuer à la réflexion sur la thématique de l’inculturation en Afrique subsaharienne, nous pensons que l’enracinement dans l’œuvre d’un Père-pionnier est important pour ouvrir de nouvelles perspectives.
Pour effectuer notre recherche, nous avons articulé le corps du travail autour de quatre parties. La démarche à partir de laquelle nous avons développé chacune de ces parties est elle-même structurée par : des synthèses culturelles, bibliques et patristiques de la plupart des doctrines étudiées, des analyses doctrinales et culturelles de plusieurs textes du corpus nazianzène, des reprises synthétiques dans lesquelles nous faisons ressortir des perspectives et des pistes de réflexion. Il nous a aussi paru utile de présenter parfois, de façon brève, certaines doctrines hérétiques que Grégoire combattait.
Après avoir montré, entre autres, dans la première partie que chez Grégoire, l’hellénisme est une réalité paradoxale qui comporte à la fois des forces et des limites, nous nous sommes intéressé dans la deuxième partie à sa réflexion sur la théologie et sur la création. L’une des lignes capitales de cette deuxième partie, à savoir la continuité entre théologie et création, nous a ouvert la voie à la troisième partie consacrée à la réflexion nazianzène sur la révélation des Personnes trinitaires dans le monde. Cette révélation étant une œuvre de salut, nous avons traité dans la dernière partie de la thèse la question de la divinisation de l’homme ici-bas et dans l’Au-delà. L’une des pistes principales qui se dégagent de notre analyse des différentes parties de la recherche consiste à soutenir que, bien qu’il vise l’universel et se fonde sur des vérités irréductibles à une époque, le propos biblique manifeste davantage sa richesse pour un milieu donné si on le fait dialoguer avec les réalités culturelles propres à ce milieu soit en vue de les purifier, soit en vue d’un enrichissement réciproque. Une telle conviction nous a permis, dans la conclusion générale, de mieux apprécier certains préjugés culturels propres aux peuples de l’Afrique subsaharienne et de proposer des pistes qui nous semblent utiles pour la réflexion en théologie négro-africaine de l’inculturation. »